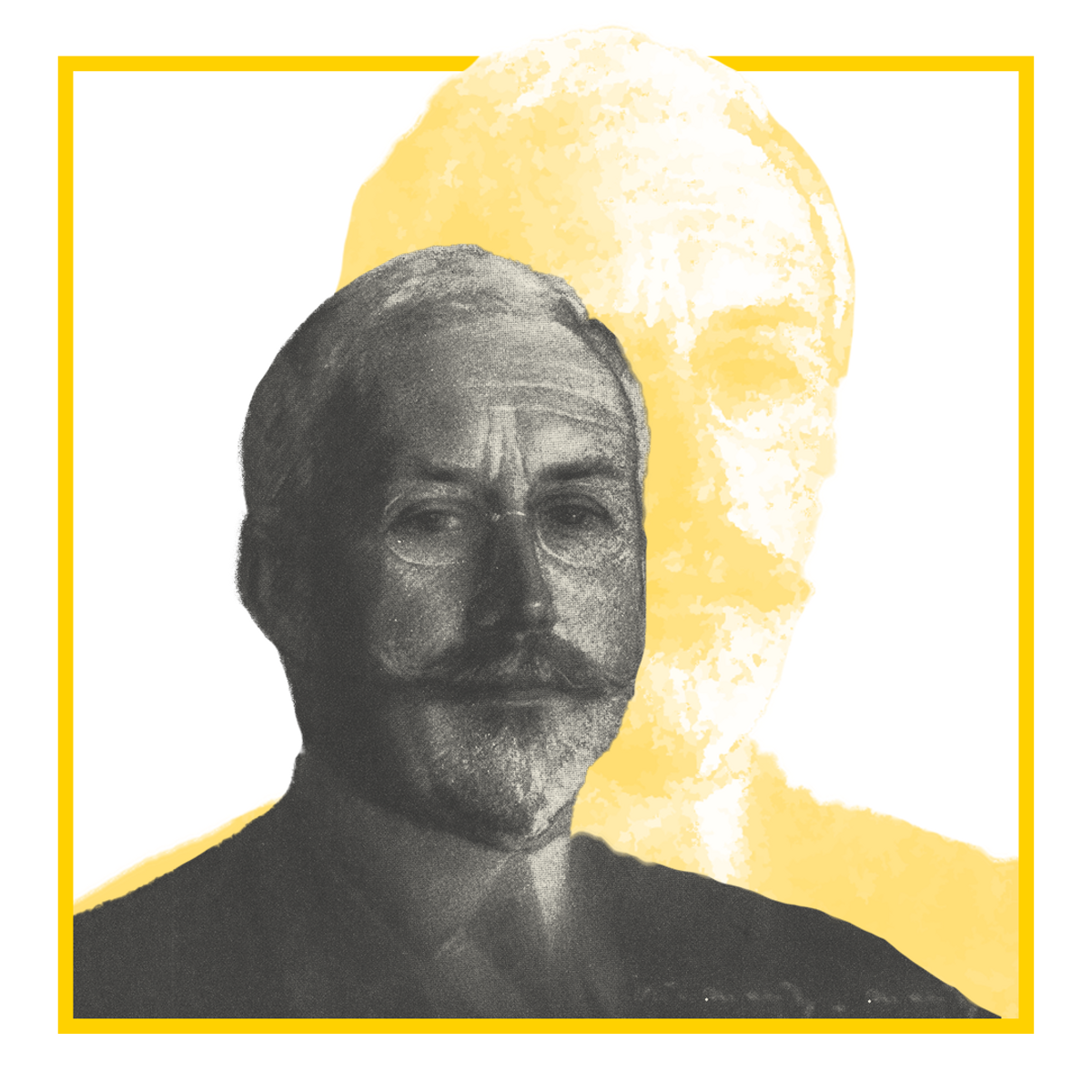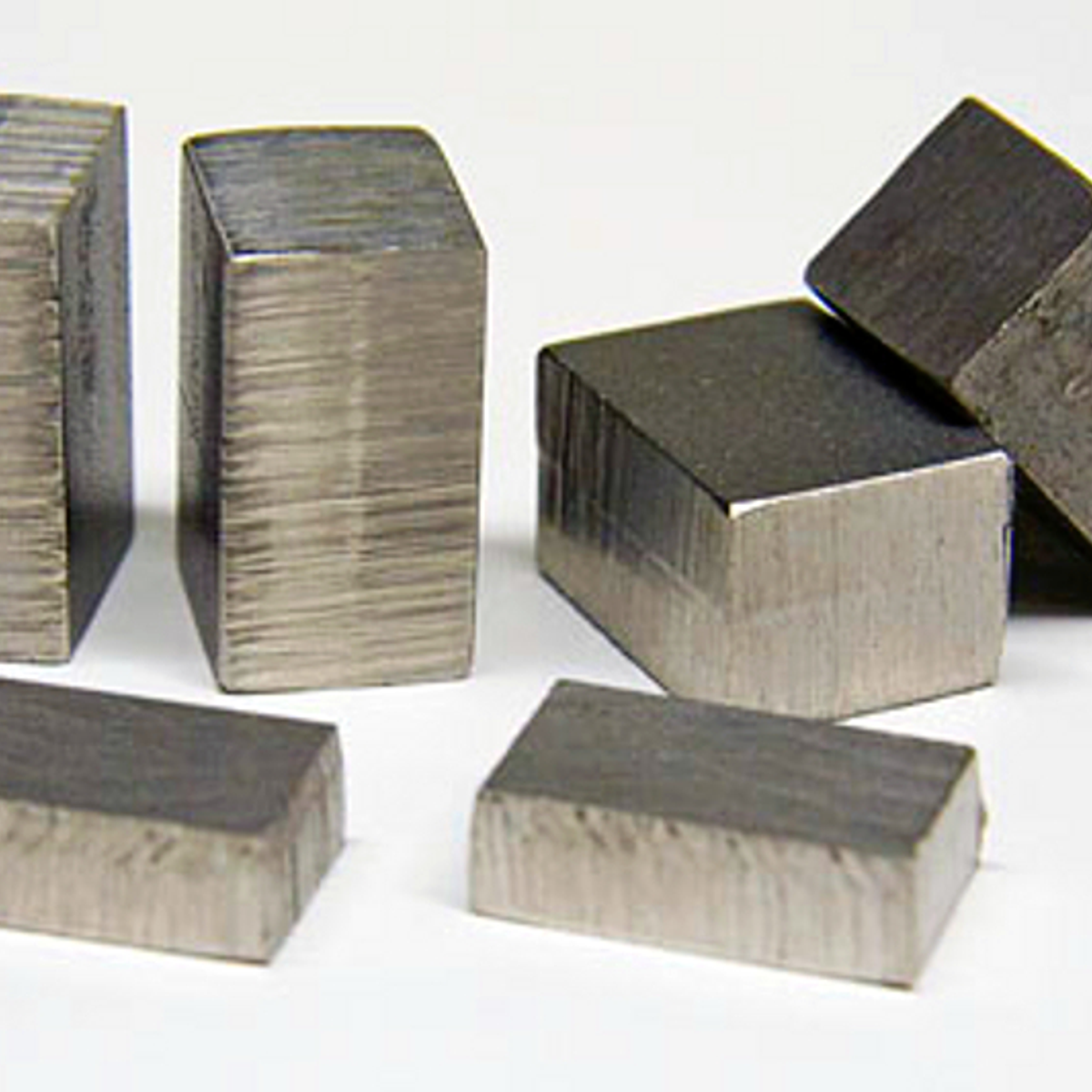Fils d’un artisan horloger, Charles-Édouard Guillaume, né en 1861, termine ses études en 1883 au bénéfice d’un doctorat en physique obtenu à l’École polytechnique fédérale de Zurich. La même année, il entre au Bureau international des poids et mesures à Sèvres, près de Paris. Il y passe cinquante-trois ans, dont les vingt et une dernières années comme directeur. Dès le début de ses recherches en 1894, la carrière de Charles-Édouard Guillaume est marquée par son obstination à améliorer la fiabilité des alliages de métaux, notamment les alliages ferronickel, destinés à la métrologie dans la mesure des longueurs comme dans celles du temps. C’est plus de 600 alliages qu’il fait fabriquer et qu’il teste. En 1896, ses expériences portent sur un alliage composé de fer et de 36 % de nickel qu’il nomme « invar » (abréviation d’« invariable »), à dilatabilité invariable. Ce nouveau métal a une dilatabilité d’un tiers plus faible que celle du platine irradié, considéré jusqu’alors comme le métal le plus fiable en métrologie. Fils d’horloger, Charles-Édouard Guillaume a très vite saisi le grand intérêt présenté par des métaux insensibles aux variations de température pour la précision des appareils horaires. Avec l’invar, qui reste stable dans ses dimensions même si la température change, son application en horlogerie comme tige des pendules de précision s’imposait.
Charles-Édouard Guillaume
Personnages célèbres
Lauréat du prix Nobel de physique en 1920, Charles-Édouard Guillaume aura contribué par ses recherches à une plus grande fiabilité dans les instruments de la mesure du temps et des longueurs, tout en favorisant l’essor de toute une métallurgie de précision.
Dès 1912, ses recherches amènent Charles-Édouard Guillaume à la découverte d’un autre alliage qualifié d’élinvar (pour « élasticité invariable »). D’une élasticité constante, ce nouvel alliage allait se révéler parfaitement adapté à la fabrication d’un spiral compensateur. Associé à un balancier monométallique, ce nouveau type de spiral permettait d’assurer une compensation complète. Encore à son actif, un autre alliage baptisé « anibal », pour « acier au nickel », pour balancier. L’ensemble des travaux de Charles-Édouard Guillaume lui ont valu le prix Nobel de physique en 1920, un an avant celui décerné à un autre Suisse en la personne d’Albert Einstein. Décédé à Sèvres peu de temps après sa retraire, Charles-Édouard Guillaume aura contribué par ses recherches à une plus grande fiabilité dans les instruments de la mesure du temps et des longueurs, tout en favorisant l’essor de toute une métallurgie de précision. Les métaux qu’il a mis au point servent encore dans les thermomètres pour les cuves des méthaniers et restent à la base des subtils alliages pour les spiraux horlogers.
1895
Mise au point de l’invar (abréviation d’« invariable »), alliage d’acier et de nickel pour la fabrication de pendules de précision.
1919
Mise au point de l’élinvar (abréviation d’« élasticité invariable »), alliage d’acier et de nickel contenant du chrome et du tungstène pour la fabrication des spiraux de montre.
1920
Lauréat du prix Nobel de physique.