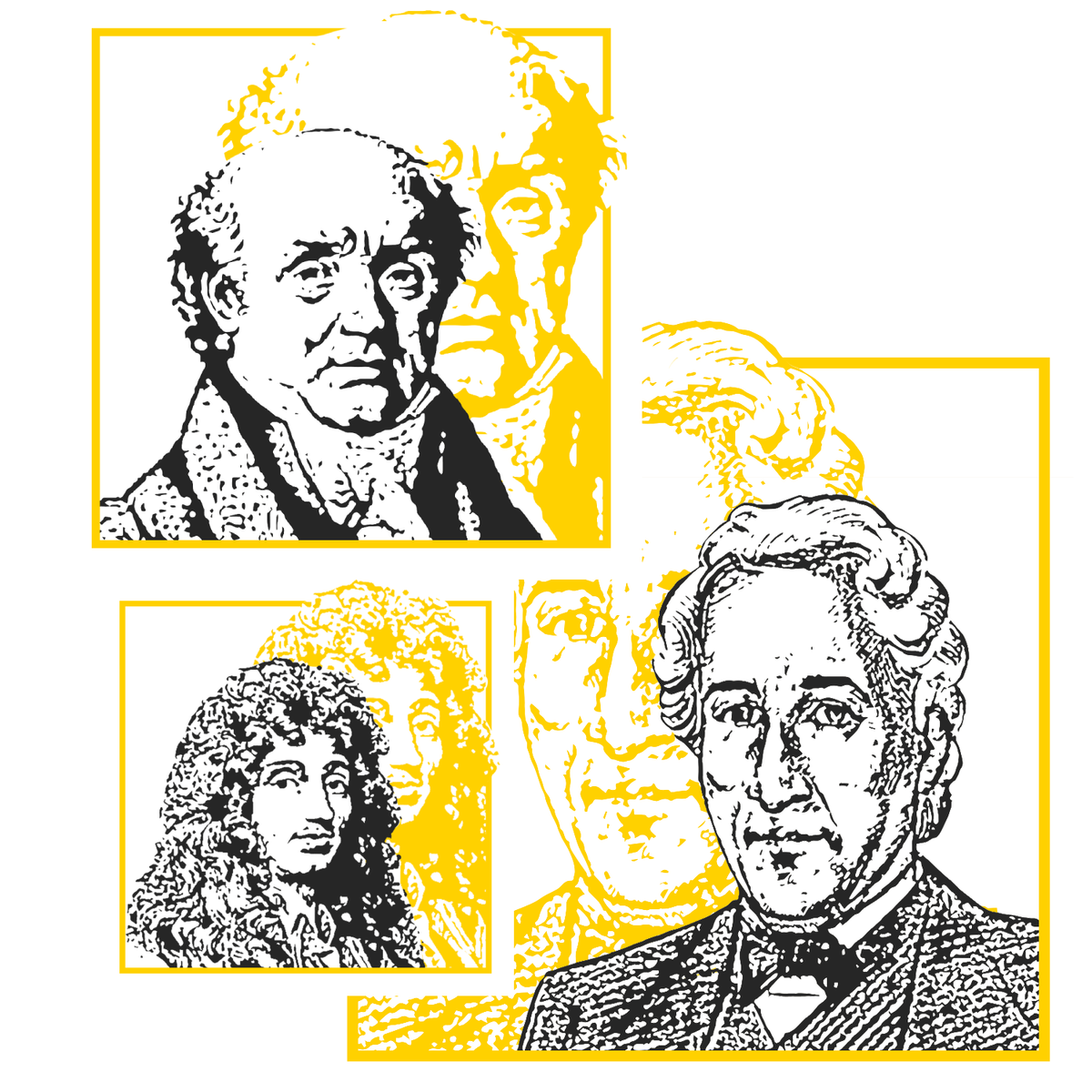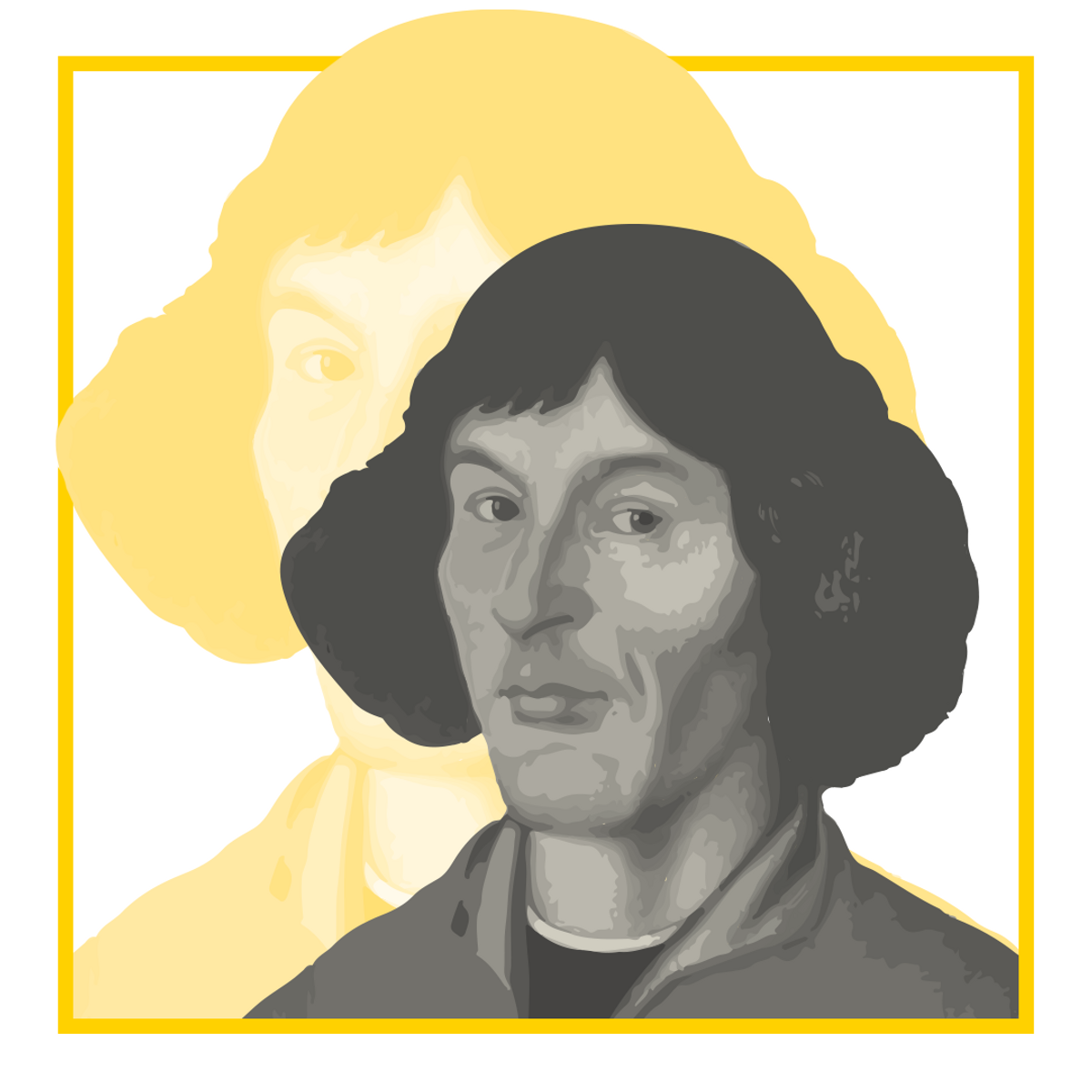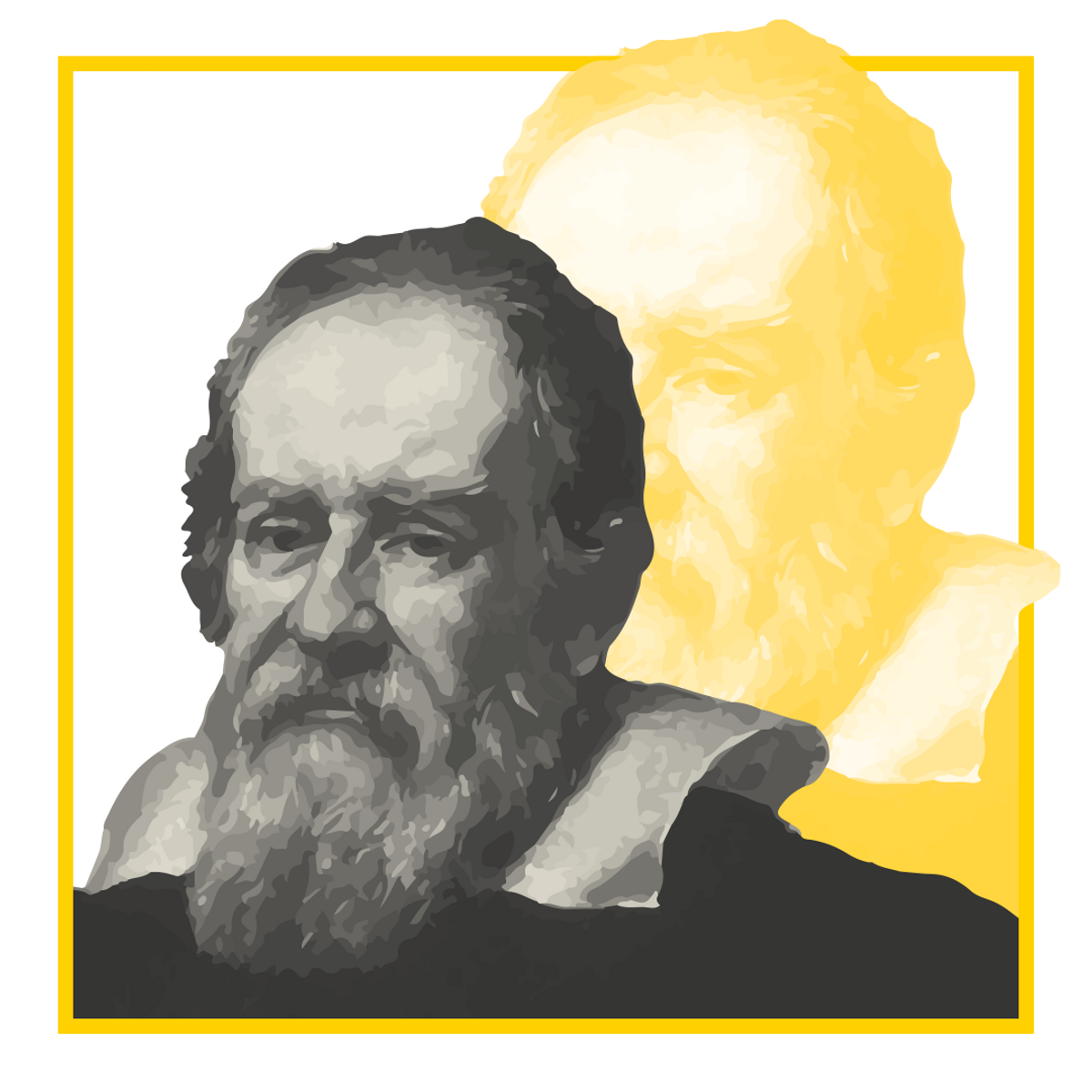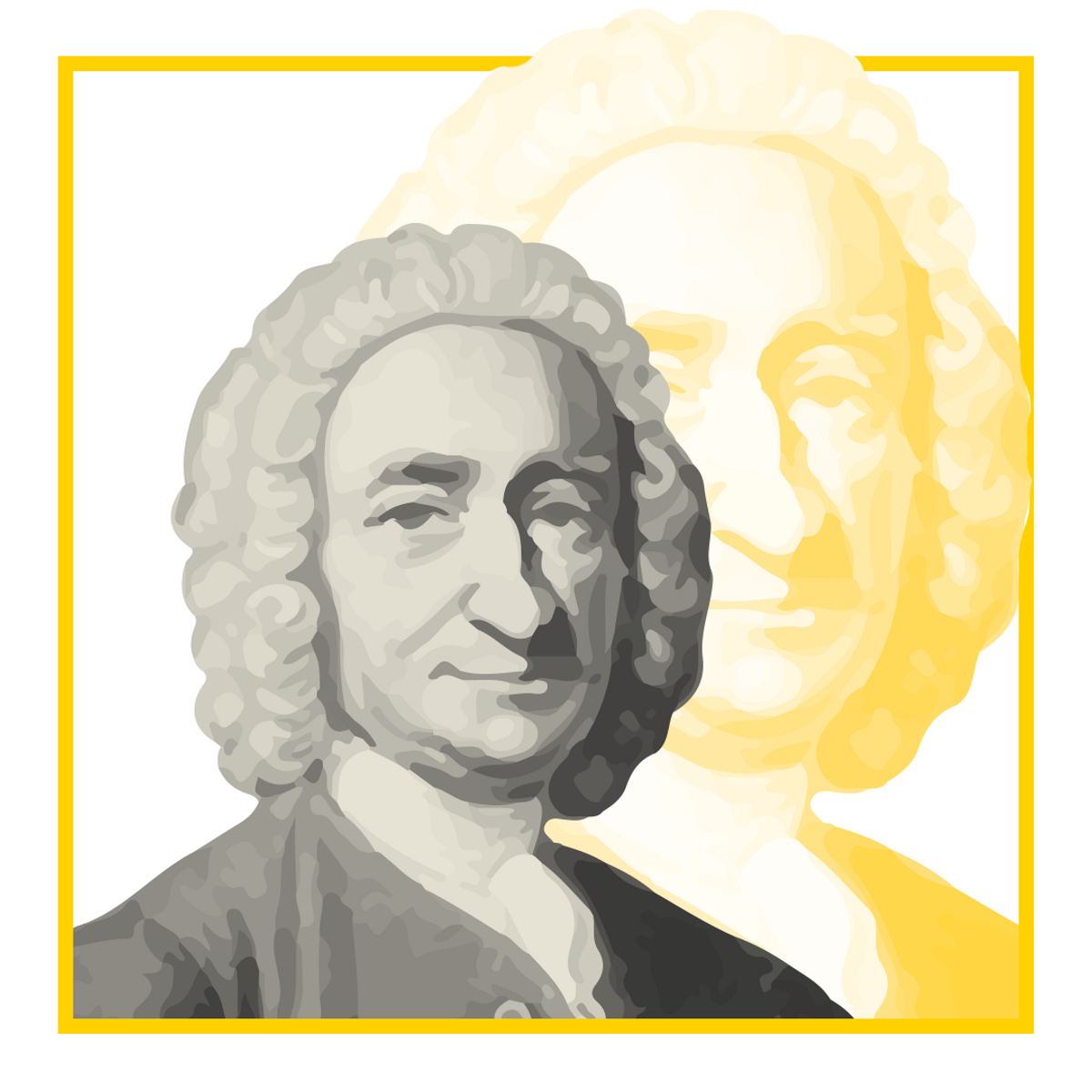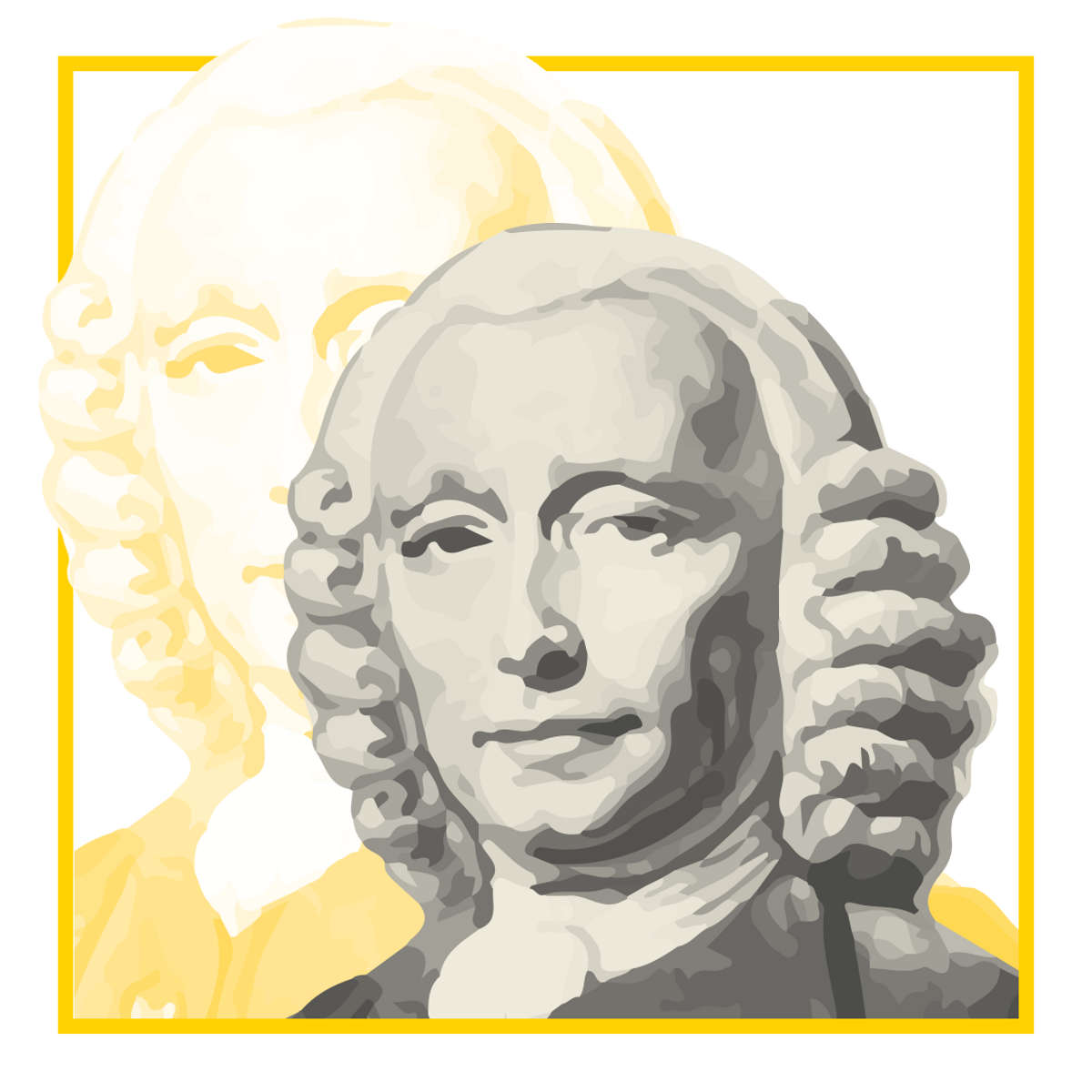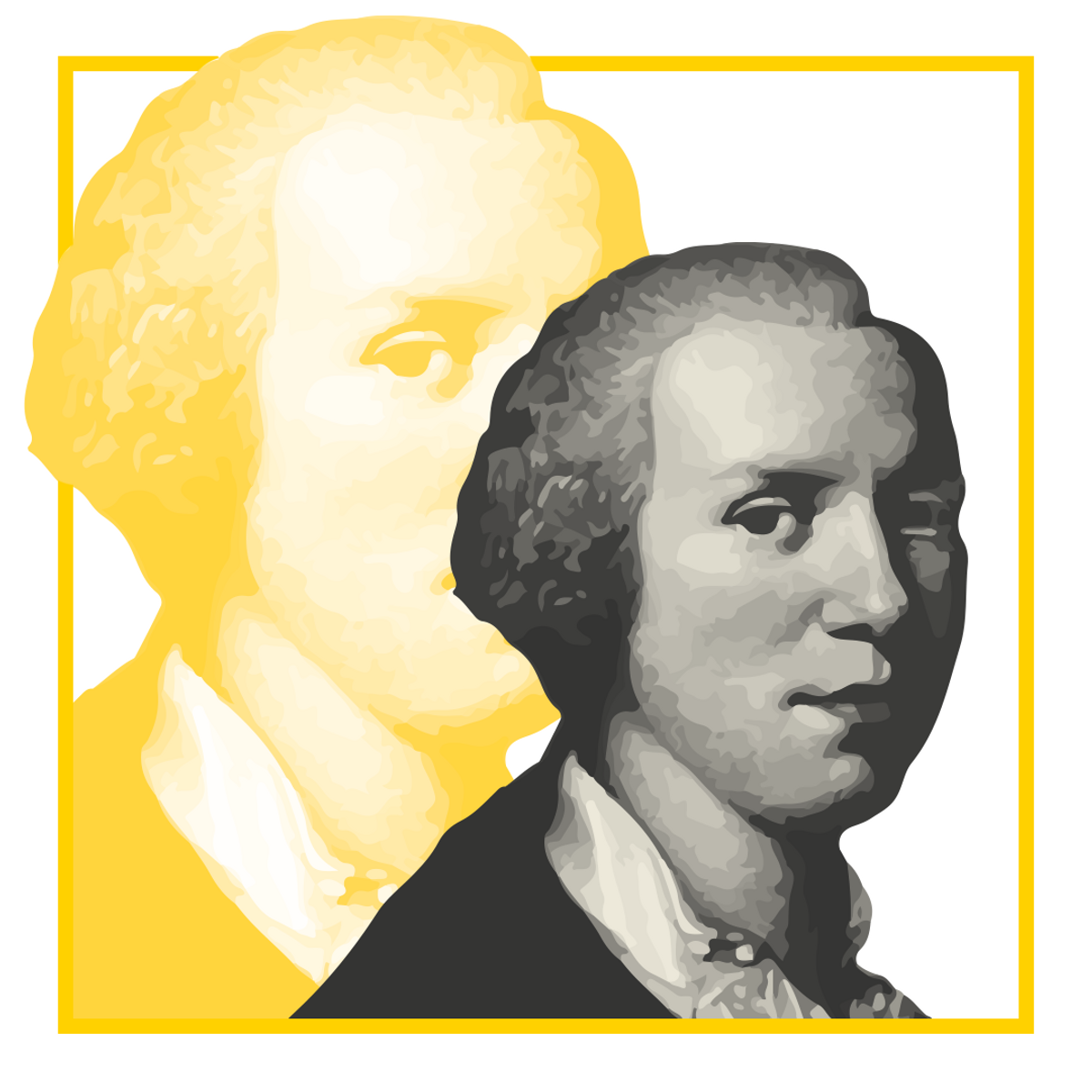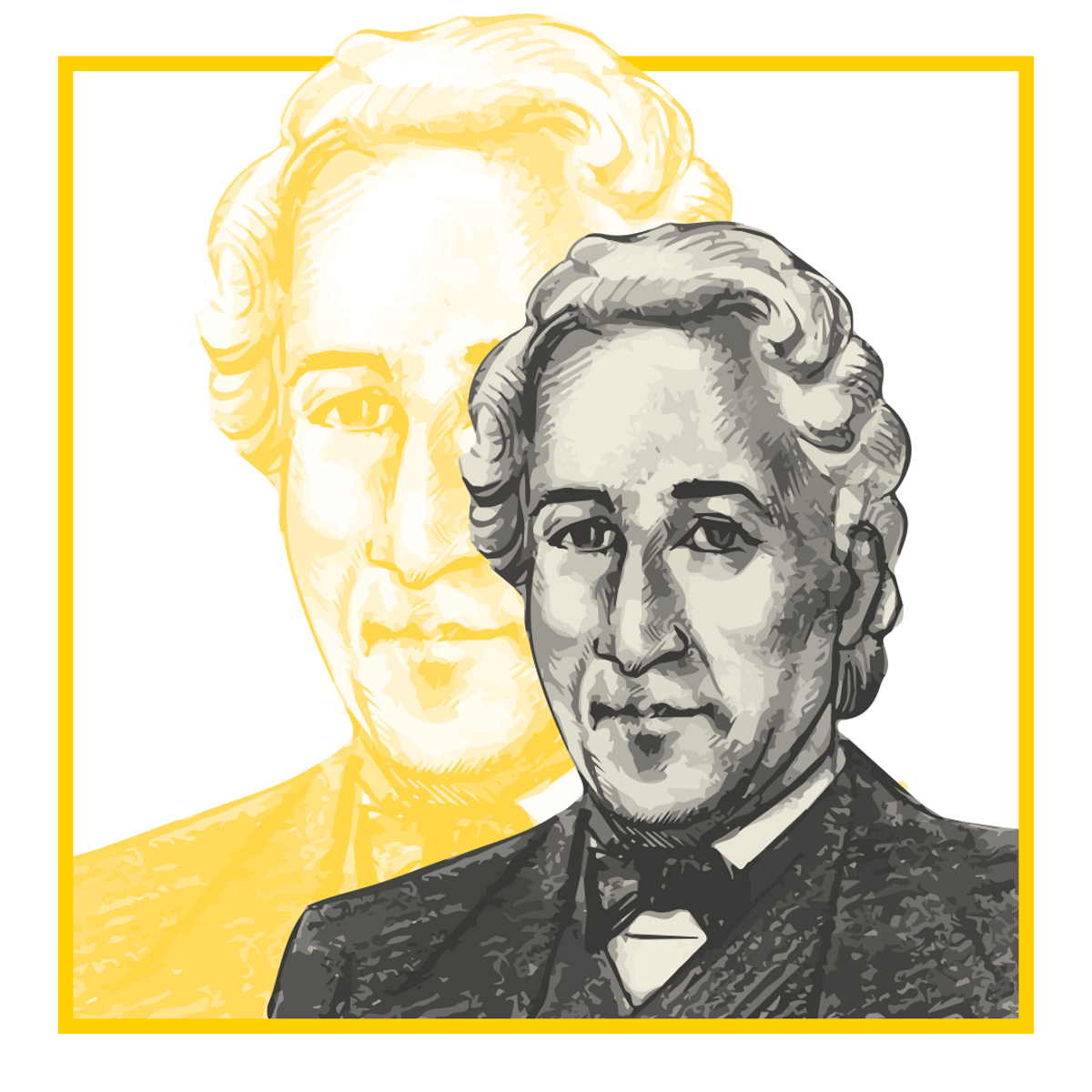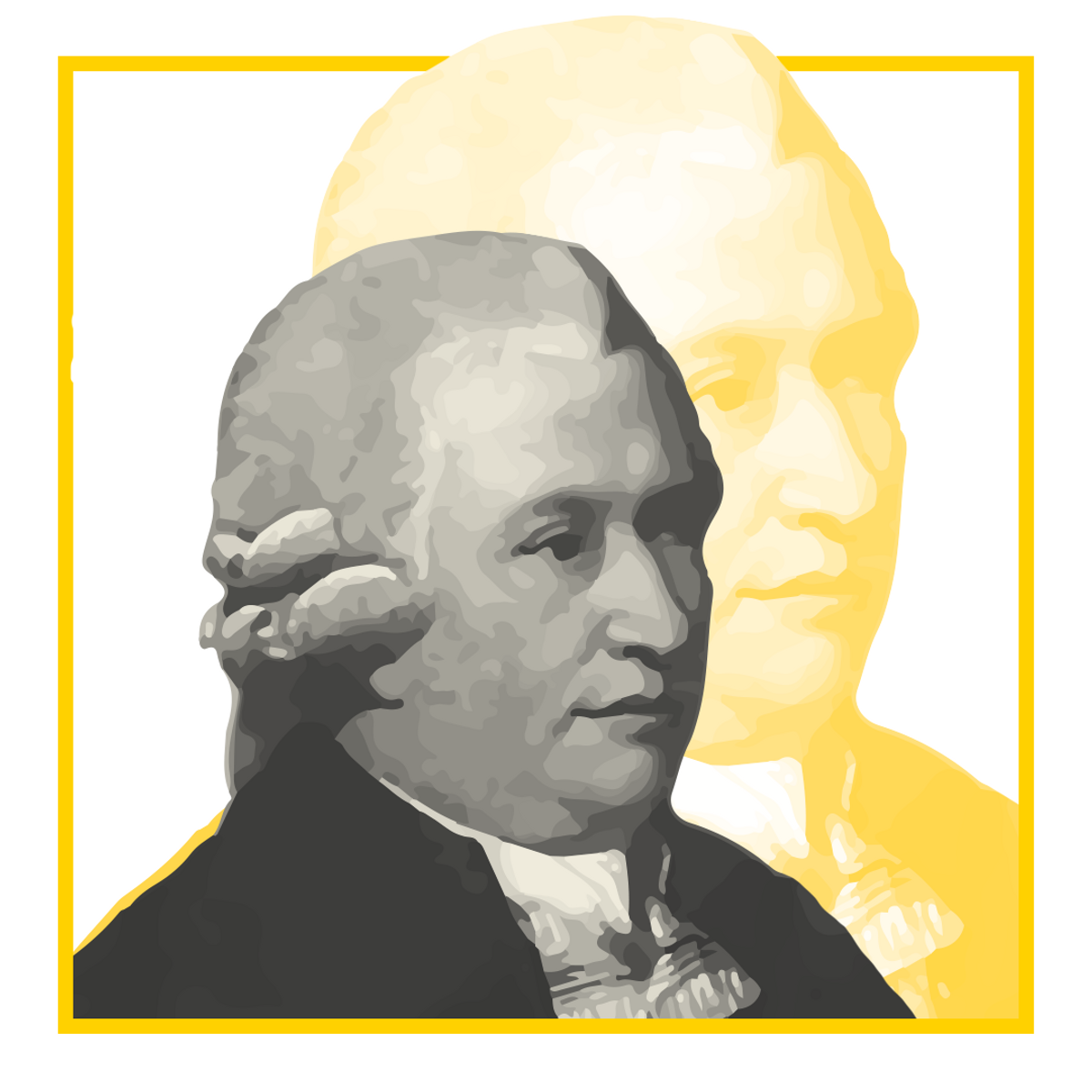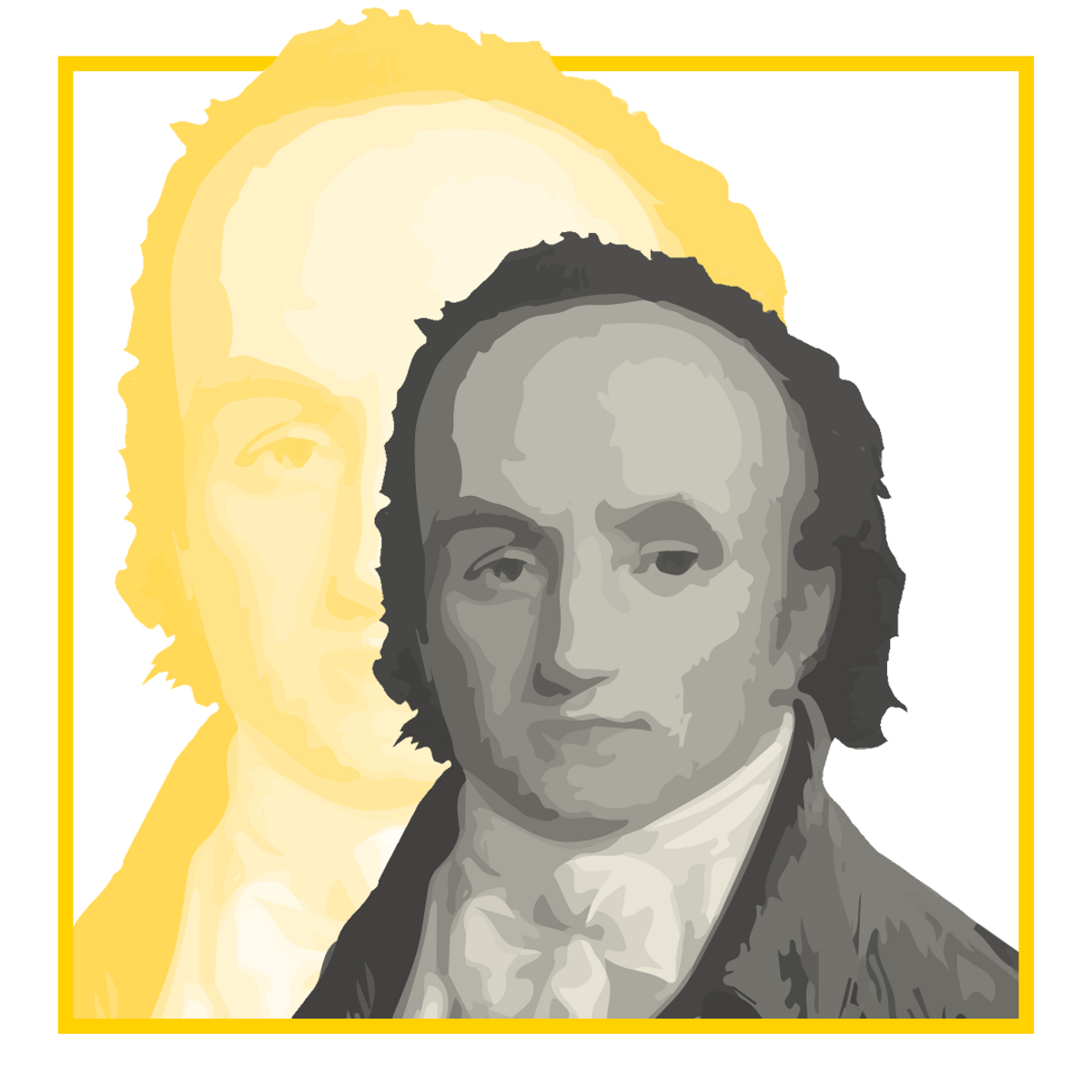Dans son infinie modestie, l’homme a très longtemps pensé que tout tournait autour de lui. Exprimé en termes de cosmologie ou structure de l’univers, cela veut dire qu’il était persuadé que la Terre se tenait immobile au centre de monde. Les plus éminents érudits comme Aristote ou Ptolémée ne l’avaient-pas démontré ? Tout comme ils avaient calculé les distances séparant la Terre des deux « luminaires » que sont le Soleil et la Lune et des cinq planètes visibles à l’œil nu : Mercure, Vénus, Mars Jupiter et Saturne. A l’exception notable de celle d’Aristarque de Samos, qui vécut au 3e siècle av. JC, toutes les cosmologies de l’Antiquité étaient ainsi géocentriques. Si bien que l’Eglise en fut l’ardente défenseure, confortée par les Saines-Ecritures qui placent la Terre au centre de l’univers. « C’est pourquoi la terre est ferme, elle ne peut vaciller », peut-on notamment lire dans le psaume 19. Erigée en dogme, cette théorie n’a rencontré que peu de contestation au cours de siècles. Et pour cause. Tout savant qui osait en nier les fondements passait pour un hérétique. Et l’on connaît le sort réservé par l’Inquisition à toute personne qui remettait en cause l’orthodoxie de l’Eglise. Le philosophe italien Giordano Bruno, condamné au bûcher en 1600, en a fait l’expérience.
Esprit universel comme il en fut de remarquables à la Renaissance, le polonais Nicolas Copernic ne s’en est toutefois pas laissé compter. Scientifique au sens large, il devait d’abord étudier les arts à l’Université de Cracovie avant de s’intéresser à la médecine, aux mathématiques et surtout à l’astronomie à l’Université de Bologne, sous la conduite de Domenico Maria Novara. De retour en Pologne, ses charges de chanoine et administrateur du diocèse de Frombork, ne l’empêchent toutefois pas de poursuivre ses recherches astronomiques depuis son observatoire. C’est là qu’il conçoit son système héliocentrique, où la Terre tourne sur elle-même avec la Lune pour satellite et où toutes les planètes effectuent leur révolution autour du Soleil. Ces théories, il va les développer dans deux ouvrages majeurs. Courageux mais pas téméraire, Copernic va toutefois en retarder la publication. Le premier ne sera édité qu’au 19e siècle, tandis que le second, achevé en 1430, ne paraîtra que 13 ans plus tard, le jour de sa mort. Copernic était destiné à être un auteur que l’on se passait sous le manteau, de peur de finir dans les geôles de la Curie romaine.